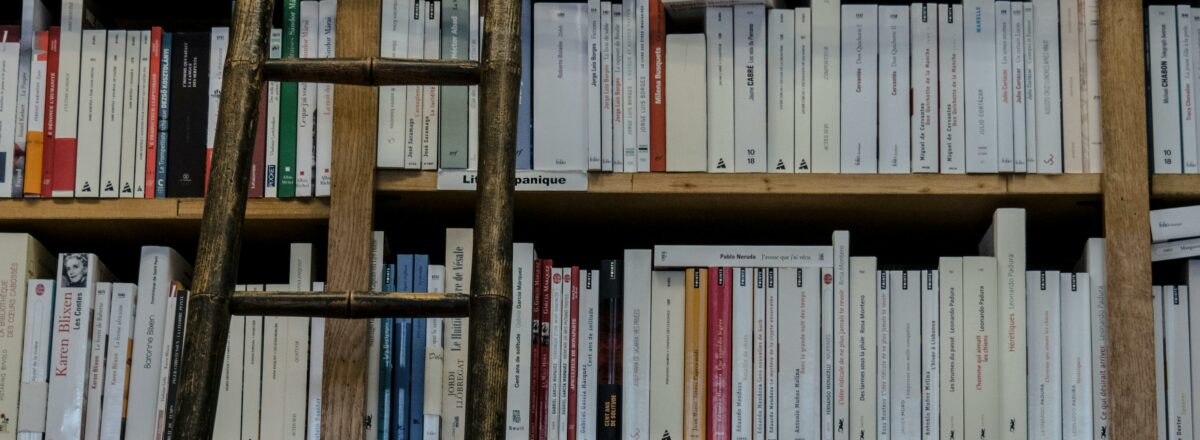Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du monde en librairie en cette rentrée 2025 ! Parmi les titres phares, une thématique commune se dégage, véritable fil rouge de cette saison : la famille. On peut en effet observer une forte tendance à l’autofiction avec cette envie, pour les auteur·rices, de mettre en avant leurs histoires familiales, ou de rendre hommage à un proche en particulier. Citons notamment Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère, qui retrace la vie de sa mère Hélène Carrère d’Encausse et celle de ses ancêtres russes, mêlant ainsi petite et grande Histoire, Laurent Mauvignier avec La maison vide, qui explore ses origines à travers trois portraits de femmes ou encore Anne Berest et son Finistère qui remonte la lignée paternelle, sur fond de luttes sociales.
Après avoir écrit sur soi, sur ses états d’âme ou sur son couple, quoi de plus évident pour un·e écrivain·e que de revenir à ses origines ? Celles et ceux qui l’ont vu naître, témoins ou responsables de ses plus grands maux comme de ses plus grands bonheurs, deviennent alors le cœur du récit.
Le goût pour les romans familiaux s’inscrit dans une tradition littéraire plus large, mais il ne s’agit pas ici de sagas à la Zola : les récits d’aujourd’hui cherchent moins à peindre un milieu sur plusieurs générations qu’à sonder l’intime, à interroger l’héritage. Cette année, le genre semble connaître un engouement inédit, sans doute parce qu’il est porté par des écrivain·es « stars ». Dans leur cas, le récit semble même parfois passer au second plan, éclipsé par la notoriété de l’auteur·rice. Un phénomène qui tend à susciter critiques et frustrations chez certains lecteur·rices, déçu·es de constater la visibilité réduite d’auteur·rices moins connu·es et dénonçant par ailleurs l’aspect illusoire des sélections littéraires. On peut également percevoir une certaine lassitude face à cette mise en scène de soi envahissante, souvent qualifiée de narcissique et trop située socialement : les récits familiaux de cette saison concernent, pour beaucoup, une bourgeoisie blanche, intellectuelle, dont l’univers reste largement parisien.
Cependant, on ne peut nier que le thème de la famille reste très apprécié du public, sans doute parce qu’il permet aux lecteur·rices de se retrouver dans la vie des autres, qui font parfois écho à leurs expériences personnelles, et aussi parce qu’il offre un regard plus intime sur les auteur·rices, permettant de les comprendre et de les découvrir à travers leurs racines. En cette rentrée littéraire 2025, il est d’ailleurs important de mentionner que beaucoup ne se contentent pas de décrire leur univers familial. Ils ancrent leur récit dans une époque, un territoire ou une mémoire collective, donnant ainsi une portée plus large à leur histoire personnelle.
Dans un monde où les lecteur·rices oscillent entre besoin d’évasion et quête de sens, la tendance 2025 à l’autofiction interroge : signe-t-elle un retour du réel, la fin de la fiction pure ? L’autrice de Finistère se plaît à qualifier son récit de « roman vrai », brouillant ainsi un peu plus les frontières entre invention et réalité : une appellation qui répond sans conteste à notre désir d’authenticité, tout en réaffirmant la puissance du récit. Et, au fond, elle a sans doute raison : « Dans un roman, on n’y croirait pas ![1] »
[1] 22 rue Huyghens, L’actualité des Éditions Albin Michel, #37 la Rentrée Littéraire, Août-Septembre 2025